
Lise Gruel-Apert
Dans le numéro 72 de La Grande Oreille, Sur les traces de l’Ours, l’introduction de notre article « Brun, le benêt du Roman de Renart » affirmait que ce roman avait été écrit de 1175 à 1250 et que c’était un récit « de culture savante et non populaire ». Lise Gruel-Apert tient à revenir sur cette présentation.
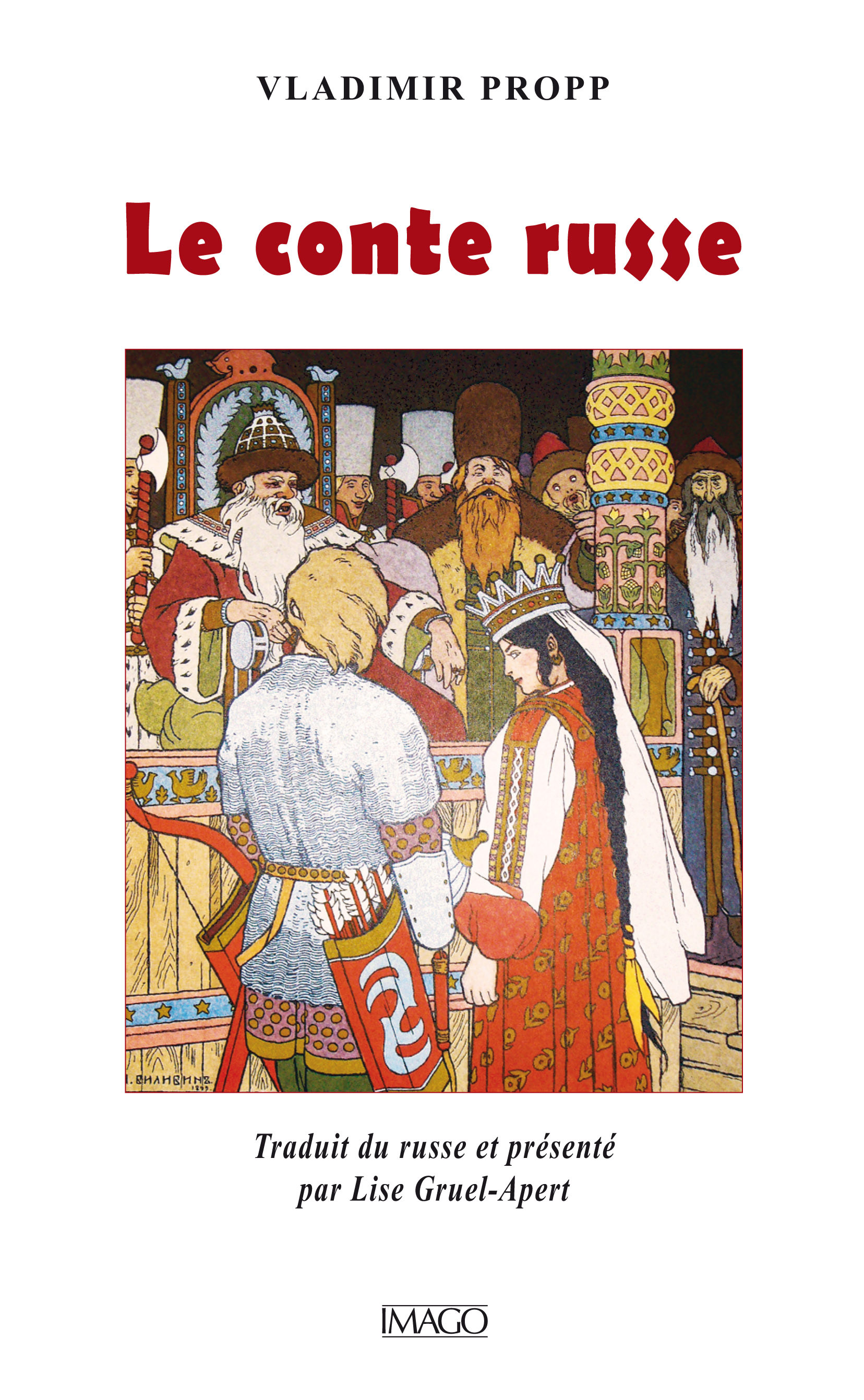
L’ouvrage récemment traduit de Vladimir Propp Le Conte russe (1) permet de nuancer ces affirmations.
Voyons d’abord les dates et les langues dans lesquelles les romans médiévaux dont fait partie Le Roman de Renart ont été écrits. Le premier d’entre eux date de 940, il est dû à un moine de Lotharingie, écrivant en latin. Puis, on trouve une version néerlandaise datant de 1148, suivie de la version française, datée de 1230 environ. La série s’achève sur plusieurs versions allemandes s’étendant jusqu’à 1794.
Autrement dit, on est en présence de plusieurs romans en différentes langues, s’étendant sur une longue période et impliquant plusieurs pays d’Europe occidentale (et pas uniquement la France). On a affaire là à une culture savante qui introduit dans sa fabulation une coloration satirique, tantôt anticléricale, tantôt politique. Une telle dimension est absente du conte populaire.
Il n’en est pas moins vrai que ces romans ont en commun avec les contes populaires d’animaux des sujets aussi connus que le vol du poisson, la pêche avec la queue, le loup idiot, etc. Or, ces sujets de contes sont, eux, bien représentés dans la tradition orale. Ils existent non seulement dans la tradition orale française (2), mais dans la tradition orale russe (3). Si l’on peut faire l’hypothèse que le Roman de Renart a influencé la tradition orale française, une telle supposition est hors de question du côté russe, vu qu’il n’existe aucun roman médiéval en langue russe. De plus, il est à noter que des recueils de contes russes provenant de l’Oural (4) ou de la Russie du nord (5), pour ne citer que ceux-là, connaissent également de tels sujets. Comment donc le paysan, le plus souvent illettré, des périphéries de la Russie, aurait-il pu connaître une traduction de l’un ou de l’autre de ces romans médiévaux ? Est-ce que l’ensemble de ces faits ne nous mènerait pas plutôt à la déduction suivante : ces romans médiévaux ont pour point de départ une culture savante, mais elle est basée, voire ancrée dans une tradition populaire. Cette tradition populaire était alors omniprésente, et les auteurs des romans médiévaux l’ont modifiée dans le sens de leurs intérêts. Et c’est cet ancrage réussi qui a fait le succès du Roman de Renart à travers les siècles.
Disons en conclusion que les rapports entre culture savante et culture populaire sont complexes et ne peuvent être tranchés trop rapidement, et reconnaissons avec Propp que la transmission orale existe et qu’elle peut être très différente de la transmission écrite (6).
Notes :
1. Vladimir Propp, Le Conte russe, trad. Lise Gruel-Appert, Paris, Imago, 2017, p.184-186
2. Paul Delarue et Marie-Louis Tenèze, Le Conte populaire français, tome III, G.-P. Maisonneuve et Larose, 1976
3. Alexandre Afanassiev, Les Contes populaires russes, trad. Lise Gruel-Apert, tome I, Imago, 2009. Et je ne parle pas ici de la tradition orale germanique, probablement concernée aussi !
4. Dimitri Zélénine, Les Contes grands-russes de la province de Perm, Petrograd, 1914 ; et Dimitri Zélénine, Les Contes grands-russes de la province de Viatka, Petrograd, 1915.
5. Les Contes du Nord dans le recueil d’Ontchoukov, Saint-Pétersbourg, 1908
6. Le Conte russe, p.244
Le plus célèbre des conteurs québécois est en tournée à travers la France du 4 au 13 avril avec son nouveau spectacle « Un village en trois dés ». En octobre-novembre 2017, il l’avait rodé pendant un mois au Théâtre de l’Atelier, avant même de le présenter à Montréal. Nous l’avions rencontré lors de son passage à Paris.

Comment vous définiriez-vous ? Plutôt comme un conteur ou comme un humoriste ?
Je me définis plutôt comme un « conteux », et non comme un « conteur », parce que, chez nous, dans ce « -x » final, il y a une dimension artisanale. Au Québec, quand tu n’as pas la prétention d’être accordéoniste mais que tu joues de l’accordéon, tu es un « accordéoneux ». Ou bien tu es un « violoneux » plutôt qu’un « violoniste ». Mais je me suis quand même souvent posé la question, vu que je fais beaucoup rire aussi dans mes spectacles, est-ce de l’humour ou pas ? Je l’ai également posée à des gens autour de moi. Je me rappelle, entre autres, la réponse du conteur Jihad Darwiche, qui m’a dit : <em>« Tu n’as pas besoin de te mettre une étiquette toi-même »</em>, lui, il parlait de « conte », et puis il estimait qu’après, les gens en faisaient ce qu’ils en voulaient. Pour ma part, je considère que je conte, parce que mon souci premier, c’est avant tout de raconter une histoire. Certes, je fais rire, mais je ne fais pas que ça, j’essaie de dire quelque chose, de mettre toujours une dimension poétique dans ce que je fais, de susciter d’autres émotions que celles qui se trouvent dans le coin du rire. Dans le spectacle que je présente actuellement, il y a la place pour des larmes. Pour moi, l’humour, le rire, et toutes les autres émotions aussi, ce ne sont que des outils, mais l’objectif final reste de faire voyager le public avec mes histoires.
Pourquoi avez-vous consacré un sixième spectacle à votre village de Saint-Elie-de-Caxton ?
Pour moi, ce village, ce n’est pas juste un truc comme ça… Avant toute chose, il y a un véritable engagement citoyen, une participation active à une vie collective, entre voisins, à travers l’invention de projets culturels, d’événements pour animer cette communauté. Les histoires que je conte, c’est l’expression de cette citoyenneté de Saint-Elie-de-Caxton. Le vrai laboratoire de ma vie, il est là. Si demain, j’arrête de conter, je continuerai de faire ce que je fais dans mon village. Tout cela s’inscrit dans une démarche qui est celle de l’implication dans le réel. Au départ, la réalité quotidienne de la vie au village a beaucoup influencé la création des mes spectacles, puis aujourd’hui, ces contes-là influencent à leur tour beaucoup le réel, il y a des retombées qui sont directement liées au succès de ces histoires auprès du public, en termes économiques avec des créations d’emplois, des améliorations de la qualité de vie, mais aussi en termes de fierté, de sentiment d’appartenance à une communauté. Si j’arrive encore à créer de nouveaux personnages pour mes spectacles, c’est en restant toujours à l’écoute des habitants de Saint-Elie-de-Caxton, de ce qui se passe, tout le temps, tous les jours. Parce que j’habite encore le cœur du village, chaque jour, je vais au bureau de poste, je vais à l’épicerie, je vais mettre de l’essence dans l’auto, puis… je baigne beaucoup là-dedans. Et puis après, aussi des fois, des nouveaux personnages, ça peut être aussi l’amalgame entre différents personnages, mais qui ont des traits qui se rejoignent, j’en crée un à partir de trois, il y a des choses comme ça. Mais c’est étonnant à quel point tous ces personnages-là sont réels. Demain, vous débarquez à Saint-Elie, vous questionnez n’importe qui sur n’importe lequel des personnages, il va vous dire où il/elle habite ou habitait.
Dans le même ordre d’idées, j’ai réalisé une série documentaire intitulée Saint-Elie-de-Légendes, qui en est déjà à sa deuxième saison, diffusée par Radio Canada. Le point de départ de cette série, c’est une question que l’on me posait souvent en interview : « Qu’est-ce que tu vas raconter quand tu auras raconté toutes les histoires du village ? » Moi je dis qu’il y a plus d’histoires qui se créent chaque jour, ou chaque semaine, que je ne peux en dire chaque soir sur scène. Et dans les épisodes de cette série, ce que l’on tente de montrer, ce sont les personnes d’aujourd’hui, bien vivantes, qui seraient potentiellement très « légendables », dans cinquante ans. Moi, je raconte les histoires des gens qui ont vécu il y a cinquante ou cent ans, et bien, dans cinquante ou cent ans, le prochain conteur pourra choisir parmi ces personnes pour raconter leurs histoires. Dans chaque épisode, on suit un(e) habitant(e) de Saint-Elie-de-Caxton dans sa vie quotidienne. Par exemple, Gaétan, un monsieur d’une cinquantaine d’années qui est un fou de l’histoire du village, ou encore Rocard, c’est « l’homme de la pelle », celui qui fait tous les travaux avec une pelle, creuser les fosses au cimetière, nettoyer les rues pendant et après l’hiver, etc.
Avez-vous des contacts, des échanges avec d’autres conteurs et conteuses au Québec ou ailleurs ?
L’idéal pour pouvoir rencontrer d’autres conteurs et avoir le temps de discuter avec eux, c’est d’assister à des festivals de contes car pendant la durée d’un festival, les occasions ne manquent pas d’échanger les uns avec les autres. Des festivals comme Vassivière, Chiny (en Belgique), etc. Mais je suis tellement tout le temps dans le jus que je n’ai plus l’occasion d’aller à des festivals depuis des années. Du coup, ma façon de me rapprocher des conteurs depuis trois-quatre ans, c’est d’utiliser ma deuxième maison à Saint-Elie-de-Caxton pour la prêter à des artistes comme lieu de résidence et de création, pour écrire de nouveaux textes, répéter de la danse, faire une préproduction d’album, etc. Avec le Regroupement du conte au Québec (RCQ), on a mis en place une résidence d’un mois chaque année en avril. Elle fait l’objet d’un appel à candidatures spécifique. Le conteur ou la conteuse choisi(e) s’installe dans la maison pour travailler à une nouvelle création. Du coup, il y a plein d’autres conteurs qui m’ont appelé pour utiliser aussi ce lieu pendant quelques jours le reste de l’année, mais ils ne sont pas intéressés par cette résidence du RCQ. Donc ils ne vont pas court-circuiter le processus de sélection pour ceux et celles qui veulent en profiter pendant le mois d’avril.
Parmi les conteurs qui sont déjà passés en résidence chez moi, il y a la conteuse Mafane (sélectionnée par le RCQ), Achille Grimaud et François Lavallée pour leur dernière création Western, Marc-André Fortin. Sur le frigo, on met les noms de tous ceux et celles qui sont passés dans la maison. C’est une façon pour moi de découvrir de nouveaux conteurs. Dans le marché que je conclus autour de ce lieu, quand je la prête, les conteurs doivent régler symboliquement la location en laissant quelque chose à la communauté, donc, s’ils ont travaillé sur des contes, à la fin de leur séjour, ils peuvent aller raconter des histoires à l’école ou organiser un petit 5 à 7, un apéro pour présenter leur nouvelle création, ou aller à la résidence des vieux pour récolter trois-quatre histoires. C’est aussi ça le conte à Saint-Elie-de-Caxton, un échange avec les habitants.
Propos recueillis par Cristina Marino
Dates de la tournée de Fred Pellerin en France :
4 avril : Théâtre de Jouy-le-Moutier (Val d’Oise)
5 avril : La Renaissance à Mondeville (Calvados)
6 avril : Piano’cktail à Bouguenais (Loire-Atlantique)
7 avril : Théâtre de l’Hôtel de Ville à Saint-Barthélémy-d’Anjou (Maine-et-Loire)
9 et 10 avril : Scène Nationale à Quimper (Finistère)
11 avril : Théâtre du Blavet à Inzinzac-Lochrist (Morbihan)
12 avril : Atelier Culturel à Landerneau (Finistère)
13 avril : Festival Mythos à Rennes (Ille-et-Vilaine)
Plus d’informations sur le site officiel : www.fredpellerin.com et sur le compte Facebook : www.facebook.com/Fred-Pellerin-118379935225
Côté vidéo, un entretien avec Fred Pellerin réalisé par Patrick Simonin dans le cadre de l’émission L’Invité sur TV5 Monde (en octobre 2017) :
CRISTINA MARINO

Malgré une ambiance sonore, qui n’est décidément pas le fort des Trois Arts (beaucoup trop de bruits extérieurs, notamment en provenance de la rue, viennent parasiter la représentation, comme j’avais déjà eu l’occasion de le souligner sur ce blog), le public a été rapidement suspendu aux lèvres de la conteuse pour ne pas perdre une miette des aventures hautes en couleurs de la jeune Esther qui exerce une multitude de métiers, de mousse à tailleur d’habits, en passant par novice dans un couvent de bonnes sœurs en Nouvelle-France. Difficile de résumer ici en quelques lignes tous les malheurs qui accablent l’héroïne et l’obligent à fuir toujours plus loin dès qu’elle croit avoir enfin trouvé un lieu d’asile pour vivre en sécurité. Surtout pour ne pas trop en dévoiler et vous laisser le plaisir de les découvrir par vous-même. Sachez juste que rien ne lui est épargné, et qu’il ne fait pas bon de naître femme au milieu du XVIIIe siècle, surtout lorsque, comme Esther, on n’a aucune envie de finir mariée à 15 ans à un lointain parent que l’on ne connaît pas et que l’on rêve plutôt de liberté, d’indépendance et de grands espaces.
Les passages de théâtre d’objets et les chants qui ponctuent le récit de la conteuse apportent une véritable respiration et ne coupent pas le fil de la narration, bien au contraire, ils constituent des pauses bienvenues dans la longue succession des malheurs d’Esther. Françoise Crête interprète avec talent et passion non seulement le personnage principal d’Esther mais aussi tous les personnages secondaires que cette dernière croise dans ses aventures, que ce soit des femmes, comme la vieille courtisane qui recueille Esther après son naufrage ou des hommes, comme le chef indien (de la tribu des Hurons-Wendat) rencontré sur le bateau qui la conduit en Nouvelle-France et qui lui permet ensuite de s’échapper du navire qui la ramène en France. Tout a contribué à faire de cette représentation un très agréable moment partagé avec la conteuse et son musicien, qui s’est d’ailleurs prolongé par une discussion intéressante sur la genèse de ce projet, notamment tout le travail accompli avec Olivier Ducas et Francis Monty, du Théâtre de la Pire Espèce, pour apprendre à manipuler les objets et à les insérer de façon harmonieuse dans la narration.
Pour conclure, une chose est sûre : ce spectacle de Françoise Crête ne peut guère laisser indifférent, ne serait-ce que par les questions qu’il conduit à se poser, concernant des sujets toujours d’actualité, comme la place des femmes dans la société ou le rapport aux religions. Et ce par le biais d’un très beau et émouvant portrait d’une jeune fille éprise de liberté qui a résisté toute sa vie pour ne pas entrer dans le carcan imposé par les autres, pour ne pas suivre le troupeau et prendre son envol avec les oies sauvages.
Soirées contes aux Trois Arts, deux fois par mois, avec une scène ouverte de contes en début de mois et un spectacle le quatrième mardi de chaque mois, sauf en décembre. 21, rue des Rigoles, Paris 20e. Tél. : 01-43-49-36-27. Mail : les3arts@free.fr ou lestroisarts@gmail.com. Tarif : 10 € (une consommation comprise). Les deux prochaines soirées contes prévues en novembre sont une scène ouverte de contes, mardi 8 novembre à 20 heures, et un spectacle de Kamel Zouaoui, Regarde plutôt la mer, mardi 22 novembre à 20h30.
Des extraits du spectacle de conte et théâtre d’objets, Esther, oie sauvage, tirés d’un document de travail capté lors de la première au Festival interculturel du conte du Québec, le 18 octobre 2015 :
https://vimeo.com/153848775
__________________________________________________________________________________
CRISTINA MARINO

En parlant de lieu justement, on se prend à rêver que la médiathèque Françoise Sagan (Paris 10e), l’une des plus grandes médiathèques municipales de Paris, inaugurée en 2015, puisse peut-être accueillir un de ces jours des rendez-vous réguliers autour du conte et des arts de la parole. Nichée au cœur d’un magnifique jardin, dans le Carré historique du Clos Saint-Lazare, elle a été construite en partie avec certains éléments architecturaux (façades, toitures, escaliers et chapelle) de l’ancien hôpital-prison Saint-Lazare conçu par l’architecte Louis-Pierre Baltard (1764-1846), le père du célèbre Victor Baltard, architecte des Halles métalliques de Paris. Elle dispose de vastes espaces d’accueil répartis sur cinq étages et notamment d’une salle d’animation pour une centaine de personnes.
C’est précisément cette salle qui a servi d’écrin, le temps d’une soirée, mercredi 28 septembre, à la représentation du spectacle de Nathalie Leone, Le ciel a du génie, proposée dans le cadre du rendez-vous mensuel, Dix en scène, initié par la mairie du 10e arrondissement. Un écrin de choix avec une scène digne de ce nom, un grand mur blanc en toile de fond baigné d’une lumière bleutée (en harmonie avec la tonalité générale du spectacle) pour un récit d’une richesse exceptionnelle et d’une grande originalité.
Créé en 2011 sous le titre initial de Vie et presque mort de Daniel Liebevich, ce spectacle a été conçu au départ pour mélanger conte, musique et manipulation lumineuse d’objets (avec un rétroprojecteur et un grand écran). Sous un autre titre, Le ciel a du génie, il a évolué vers une version plus « nue » dans laquelle la conteuse intervient seule sur scène pour narrer son histoire. Et c’est sans doute dans ce dépouillement (ou dénuement) scénique que la puissance évocatrice de ce conte poétique oscillant constamment entre réalité et imaginaire prend toute sa force. Le spectateur se laisse littéralement emporter sur les ailes, non pas du désir (même si l’atmosphère générale de ce récit n’est pas sans évoquer le film de Wim Wenders, réalisé en 1987), mais de l’un des personnages centraux de l’histoire, Daniel Liebevich. Devenu successivement guetteur de messie, puis « sage » pour répondre aux questions des clients au fond d’une librairie, il finit par se transformer, après avoir eu le crâne fracassé par une tuile tombée d’un toit, en esprit, en fantôme ou en ange (au choix) qui revient hanter les rues de Paris, en particulier dans les quartiers du Marais, du Faubourg Saint-Antoine ou de la gare d’Austerlitz dans les années 1980.
Nathalie Leone réussit l’exploit de réunir dans une même narration une véritable visite guidée de certains quartiers parisiens, avec plein de détails et d’anecdotes très concrets, et une évasion constante vers le merveilleux, vers un univers imaginaire empli de poésie (des extraits d’un poème de Musset sont récités sur scène) et de magie. Elle peuple son récit de toute une galerie de personnages particulièrement bien campés et attachants, tels la jeune Nina à la recherche du grand amour, et son timide prétendant, Octave. Ou encore ce clochard au grand cœur qui n’hésite pas à plonger dans la Seine pour secourir un candidat au suicide.
Pour rédiger la trame de cette histoire, elle s’est inspirée non seulement de récits de vie, de témoignages, d’expériences qu’elle a personnellement vécues (l’histoire du clochard bon samaritain est ainsi en grande partie vraie ou encore celle de la cliente qui souhaite faire fabriquer un moulage de son gâteau d’anniversaire a été collectée dans un ateliers de mouleurs du côté de Belleville), mais aussi de la tradition orale populaire, avec notamment un conte traditionnel japonais sur un couple qui laisse des voleurs agir impunément sous ses yeux par peur de parler en premier et perdre ainsi le pari qu’ils ont fait. Nathalie Leone a également puisé son inspiration du côté de la littérature, notamment les nouvelles de Cyrille Fleischman, auteur de Rendez-vous au métro Saint-Paul, avec son personnage de Modestschlosser. La description très vivante qu’elle fait des rues et des quartiers du Paris des années 1980 donne une folle envie d’aller s’y balader dès la sortie du spectacle et de prendre le temps de flâner avec l’espoir de croiser, qui sait, au détour d’une ruelle, l’esprit vagabond et bienveillant de Daniel Liebevich.
Le ciel a du génie, de et par Nathalie Leone. Les dates des prochains spectacles de Nathalie Leone sont à retrouver dans la rubrique Agenda de son site Internet : nathalieleone.fr/agenda
Côté vidéo, quelques extraits du spectacle de Nathalie Leone, Vie et presque mort de Daniel Liebevich (rebaptisé depuis Le ciel a du génie), dans sa version avec musicien (Olivier Ombredane) et manipulation d’objets sur une table lumineuse, en 2012 : https://youtu.be/IJ7MENZonoQ
__________________________________________________________________________________
JIHAD DARWICHE
MARTINE CRIBIER-KOZYRA

Lors de la première nuit, Shéhérazade commence à pleurer. Le roi lui dit : « Tu savais que le matin tu allais mourir ! Ce n’est pas pour ça que je pleure, dit-elle. Nous, les humains, un jour ou l’autre, on doit tous mourir. J’aurais aimé voir ma sœur que j’aime beaucoup avant de mourir. » Douniazad est venue. « Ma sœur, toi qui vas mourir bientôt, est-ce que tu peux encore me raconter l’un de ces beaux contes que tu connais ? » Le roi le voulait bien, alors Shéhérazade a commencé un conte… le roi a commencé à aimer ce qu’il entendait.
À l’époque en Orient, on ne racontait jamais le jour ; le matin venu, le récit n’était pas fini. Le roi a dit : « Ta sœur n’a pas entendu la fin de l’histoire. Je te laisse la vie sauve mais pas d’illusion, demain tu devras mourir. »
Pendant 1001 nuits, Shéhérazade raconte des contes au roi, en faisant semblant de raconter à sa sœur. « Voilà, mes contes sont finis, ma vie t’appartient. » Le roi a regardé cette femme qui avait fait de lui un être humain, il n’avait plus envie de tuer personne, il n’était plus le même. Shéhérazade a ainsi sauvé la tête de toutes les femmes du royaume.
Pour Jihad Darwiche, elle est une femme qui a une stratégie bien précise, qui a pris sa décision tranquillement. C’était le moment, il fallait y aller.
Shéhérazade est une initiatrice. Conciliante, elle travaille en douceur, avec bienveillance
et amène le roi à adopter une attitude nouvelle, un regard différent sur la vie. Plusieurs fois, le roi dit : « Je n’aime pas ce conte. » Et Shéhérazade répond : « Je vais t’en raconter un autre. »
Qui sont les femmes de la place Tahrir ?
Jihad Darwiche a toujours été intéressé par les récits des petites gens, fasciné de voir comment ils restent debout au milieu d’une catastrophe qui dépasse le raisonnement humain. Il a tout de suite été attentif à l’attitude des femmes du Caire. « Descendre dans la rue, dans le monde arabe, pour un homme, c’est un risque ; pour une femme, c’est prendre un double risque, encore plus en Égypte », précise-t-il. Un journaliste a recueilli des récits de femmes sur la place Tahrir. Le titre de ce recueil est une expression que plusieurs d’entre elles utilisent : « L’espoir nous a prises par surprise. » Elles ne s’attendaient pas à ce qui s’est passé.
Shéhérazade n’est pas partie chez le roi pour mourir comme ses sœurs. Elle est partie chercher la vie, combattre la mort. Les femmes égyptiennes ont toutes dit : « J’ai compris que je ne pouvais qu’aller sur la place Tahrir et y rester ». Pour elles, il fallait participer aux débats qui avaient lieu dans l’espace public.
Ce combat pour la vie de Shéhérazade et des femmes du Caire, c’est une urgence à s’engager, dans le sens le plus noble du terme, c’est-à-dire être là au moment où il faut y être.
Quand le roi, qui avait atteint le sommet de la barbarie, devient un être capable d’émotion, d’établir un lien avec ses semblables, que demande-t-il d’abord ? Qu’on écrive les contes de Shéhérazade en lettres d’or, pour que le temps qui passe ne les abime pas, c’est-à-dire pour en garder la mémoire. Pour les femmes d’Égypte qui ont accepté de parler, c’était aussi cela. Elles étaient sur la place Tahrir, et elles ont senti le besoin d’en garder la mémoire, d’en garder une trace. C’est la force des ces témoignages qui a donné à Jihad Darwiche le désir de créer un spectacle à partir d’eux.
Au début des 1001 nuits, la situation est glauque, cynique, sinistre, on ne respire plus. Shéhérazade arrive, on commence à respirer et à se dire que quelque chose peut se passer. C’était un peu pareil en Égypte : une chape de plomb, un président qui ne bouge pas, une corruption énorme, une fraude électorale reconnue par tous, y compris les officiels, une liberté d’expression réduite au minimum, pas de travail. Les gens ne rêvaient que d’une chose, partir. Il n’y avait plus moyen de vivre dignement.
Shéhérazade commence à vivre seulement au moment où elle choisit d’aller se jeter dans les bras du roi et d’affronter la mort. Les hommes et les femmes d’Égypte ont pris vie au moment où ils ont accepté de sortir et d’occuper la place Tahrir ; ils ont accepté d’affronter la mort. Tout le monde est là parce que, pour une fois, on peut parler. La parole est libérée, même des gens favorables au régime venaient discuter. Ce fut le plus grand lieu de débat que les gens ont connu en Égypte, depuis des siècles. L’important est de faire savoir qu’il y a eu cette magie-là, qu’elle a existé un jour, et donc qu’elle peut revenir.
Shéhérazade et les Mille et Une Nuits, c’est un conte ; si un conte vit, si un conte se raconte, se partage, c’est parce qu’il nous parle encore. Le jour où l’histoire de Shéhérazade ne nous parlera plus, il n’y aura plus ni envie ni besoin de la raconter. Les femmes de la place Tahrir partagent avec Shéhérazade la conviction que toute parole de vie est engagement contre la mort.
www.jihad-darwiche.com/
www.palabrages.fr/
__________________________________________________________________________________
ANTONIETTA PIZZORNO
Massimo Schuster a fait un super exposé sur Dario Fo, Massimo Cuticchio et sa pratique du « cuntu » sicilien. Il nous a présenté quelques artistes du mouvement Teatro di narrazione comme « les conteurs italiens ». Petit problème : ils ne veulent pas se définir comme conteurs.
Une jolie colline qui cache la misère
Le Teatro di narrazione se compose de quelques artistes que l’on peut compter sur les doigts d’une main.
J’ai eu l’occasion de travailler avec Laura Curino, d’échanger avec elle et d’autres sur mon métier de conteuse en France. J’ai parlé des similitudes que j’avais constatées entre leur façon de travailler et celle des conteurs. J’ai eu, la plupart du temps, des réponses dubitatives : les conteurs appartiennent au passé, certains d’entre eux ont bien commencé leur carrière par des adaptations de contes merveilleux mais c’était pour un public d’enfants. Ascanio Celestini est le seul qui affirme l’importance et l’influence du conte populaire sur son travail.
Personne n’a envie de se présenter sous l’étiquette de raccontastorie. Ils se définissent comme des acteurs qui portent sur scène des récits de vie, des narrations sur l’histoire sociale italienne et basta.
Une liberté de choix qui me fait penser à la situation en France où l’on assiste à des querelles entre anciens et nouveaux conteurs, où l’on se pose la question de comment accéder à la scène sans vendre son âme… même si, à l’opposé de l’exemple italien, plusieurs artistes gardent dans l’espace théâtral l’appellation « conteur » presque comme un label.
Mais revenons à nos moutons, où sont, en Italie, les artistes qui se déclarent conteurs ?
D’après Massimo Schuster, il faut les chercher dans cette zone un peu nébuleuse entre acteurs et artistes d’autres disciplines. L’Histoire de l’unité de l’Italie, qui ne s’est pas vraiment réalisée, explique ceci mais seuls les Italiens peuvent le comprendre. J’en suis une et je cherche… je crois que j’ai perdu mon italianisme.
J’ai compris ! Derrière un marionnettiste se cache un conteur qui se montre quand il passe la frontière et se recache quand il rentre en Italie.
J’ai une autre explication : le mot conteur raccontastorie (conteur) en Italie est banni.
La Compagnie Raccontamiunastoria, en dépit de son nom, utilise le mot anglais storyteller. Personnellement, je regrette l’utilisation de ce terme, mais c’est le seul groupe d’artistes qui raconte des contes pour un public d’adultes. Il organise un festival international de Storytellers et a lancé des séances de contes chez l’habitant appelées Salotti. Il y en a dans plusieurs villes italiennes, qui permettent d’écouter des contes traditionnels et des récits de vie sur un thème chaque fois différent.
Et le conte ?
Il est présent dans les festivals et manifestations pour enfants. Des compagnies d’acteurs, costumes et décors, jouent des contes merveilleux. Parfois un conteur, une conteuse portent la narration. C’est rare mais cela arrive.
Les bibliothèques pratiquent exclusivement la lecture dramatisée. De temps à autre seulement apparaît un conteur.
Les contes sont très présents à l’école primaire où ils sont reconnus d’utilité pédagogique et éducative. Par la suite ils disparaissent, mais l’école italienne a recours à l’oralité plus fréquemment que l’école française: les exposés, les contrôles sont faits oralement. J’ai fait mes premiers pas de conteuse dans un cours d’Histoire.
Ecco qua, voilà tout est là.
__________________________________________________________________________________
[kml_flashembed publishmethod=”static” fversion=”8.0.0″ useexpressinstall=”true” movie=”http://lagrandeoreille.com/actus/wp-content/uploads/ouvertures_flash/KARINE.swf” targetclass=”flashmovie”]

[/kml_flashembed]
Que pourrait être le nouveau conte, étant entendu que le mot « conte » renvoie au sens de « domaine artistique », et non aux contes en tant que genre de la littérature orale ?
Une réflexion de Karine Mazel-Noury, pour accompagner un mouvement en devenir.
Cet article est extrait du numéro 59-60 de La Grande Oreille.
Lire l’article en plein écran : 
Vous pouvez aussi télécharger l’article complet au format PDF à l’adresse suivante :

Cette page vous est ouverte, vos commentaires sont les bienvenus.
__________________________________________________________________________________
JACQUES COMBE
Les « néo-conteurs » sont des compositeurs
qui utilisent toutes les ressources de la grammaire théâtrale
(le mime, la danse, les effets de musique, de lumière et de vidéo).
C’est devenu un nouveau mode de « faire du théâtre ».
Le public est là pour être surpris et charmé,
non pas par une histoire, mais par une personnalité…
Daniel Fabre
(Anthropologue, directeur d’études à l’EHESS)
À propos du conte, on parle de « renouveau du conte », « d’exigence artistique », de « néo-conteur », de « nouveau conte »… Certains parlent même de « chercheurs, auteurs, dramaturges, acteurs, autant de facettes qui caractérisent la figure du conteur » (Projet ICAR de la Maison du Conte et le Centre de Production de Paroles Contemporaines de Rennes, scène des arts de la parole de Pont-Scorff).
Pourtant, comme le dit l’APAC (Association Professionnelle des Artistes Conteurs) dans sa définition de l’art du conte, « l’artiste conteur se présente en son nom, dans une adresse directe au public, pour raconter une ou plusieurs histoires. Il est, à ce titre, relié de manière fondamentale à la tradition du conteur et non à celle de l’acteur. »
C’est dit.
Mais voilà, notre monde d’aujourd’hui, à bien des égards, est marqué par la dictature de la séduction et de la gonflette. On accorde souvent plus de crédit à ce qui se présente sous une forme habile, avec une technique de virtuose. On privilégie de plus en plus le simple effet sur le sens profond et le spectaculaire est devenu une valeur. La valeur.
Voyez la politique…
Est-ce à cause de cela que la grammaire théâtrale fascine de plus en plus d’artistes conteurs pour raconter leurs histoires ? (au risque de se faire enfermer dans un nouveau genre auquel il faudrait à tout prix se conformer). À moins que cela soit la seule voie viable (et visible !) qu’il faille emprunter pour surnager parmi la multitude de propositions artistiques en tout genre ?
En utilisant les codes de la représentation et du plateau-théâtre, le conteur prend le risque de la séduction, mais aussi de l’assimilation dans la tête d’un public non averti. Alors que par le seul pouvoir de sa parole, la scénographie des récits qu’il crée est la plus belle et demande très peu de moyens.
Du coup le conteur est-il vraiment un homme de « spectacle » ? (Son imaginaire est un théâtre à lui tout seul !)
Quelle différence entre l’art du conteur et celui du comédien ?
Le comédien est un interprète. Son talent consiste à incarner un rôle créé en dehors de lui et dire une parole écrite par un autre que lui, au point qu’on peut croire que cette parole jaillit véritablement de lui-même. Art subtil…
Le conteur « véritable » est par contre auteur de sa propre version et de son propre chemin à travers l’histoire qu’il raconte. Il a créé des images nouvelles, issues de son univers personnel qu’il nourrit dans le secret de son être.
Le théâtre, son espace de jeu, son écriture et sa langue sont faits pour incarner des personnages et leurs histoires, pas pour les raconter. Et les comédiens font comme si le public n’était pas là, bien qu’ils entretiennent avec lui une conversation indirecte. Alors que le conteur est le plus souvent seul, le théâtre est un art pluriel même si aujourd’hui, pour raisons économiques, il tend vers des formes de plus en plus réduites, voire solitaires : café-théâtre, one man show, stand-up, etc.
Le conteur ne représente pas comme le fait le théâtre, il montre. Comme témoin initial, il donne à voir, en mobilisant, non seulement son imaginaire et ses sens de narrateur, mais aussi ceux du public qui est loin de rester passif. Avec ses mots, il fait apparaître des images sur l’écran intérieur de ceux qui l’écoutent et qui y mettent leur propre univers personnel. C’est la parole du conteur avec l’imaginaire du public qui façonne l’histoire. C’est une relation participative qui se vit dans l’instant de la rencontre, en live, avec dénuement et sobriété, comme un cinéaste sans caméra, sans acteur, sans éclairage ni costume…
La conséquence pour le conteur qui veut faire sa place dans les circuits de « diffusion théâtre » (plateau/scène/lumière/scénographie, etc.) c’est d’utiliser de plus en plus (et se soumettre à…) des « stratégies de séduction » avec le risque d’une assimilation voir même d’une confusion dans l’esprit du public. L’art du conte, comme acte politique autant qu’artistique, doit au contraire s’opposer à cette dictature du « m’as-tu-vu ». Cette oralité-là a besoin de simplicité, de proximité, d’une certaine humilité et même de transparence.
Sinon, quand cette sorte de séduction là s’exhibe en l’absence de toute substance digne de ce nom, le kitsch apparaît… C’est juste une forme d’expertise, d’acrobatie, de tour de magie dont n’émane aucune valeur profonde. Juste une parenthèse qui peut être divertissante, agréable à entendre et à regarder et qui éventuellement nous fera oublier notre quotidien. Mais sans plus…
Dans notre société actuelle, « société du spectacle », créer tout un univers à partir de rien, avec juste un corps et une voix (comme le font encore pas mal de conteurs et de conteuses), s’apparente à un acte de résistance au tout écran, aux images « ready-made » du cinéma, de la vidéo et des réseaux sociaux, et devient d’abord une fonction et un fait politique, avant d’être un acte artistique.
Il reste aux artistes conteurs(euses) de moins vouloir « rhabiller » systématiquement leur parole d’éléments de « modernité », et de plutôt chercher avant tout l’essentiel, la profondeur de l’histoire et sa pertinence pour notre monde d’aujourd’hui.
Raconter une histoire, à voix nue, avec sa simple, mais profonde humanité, voilà bien un chantier à (re)conquérir après avoir trop utilisé les « stratégies du spectaculaire ». Sinon, dans ce monde en perte de sens, on aura l’air malin avec nos histoires… gesticulées.
__________________________________________________________________________________
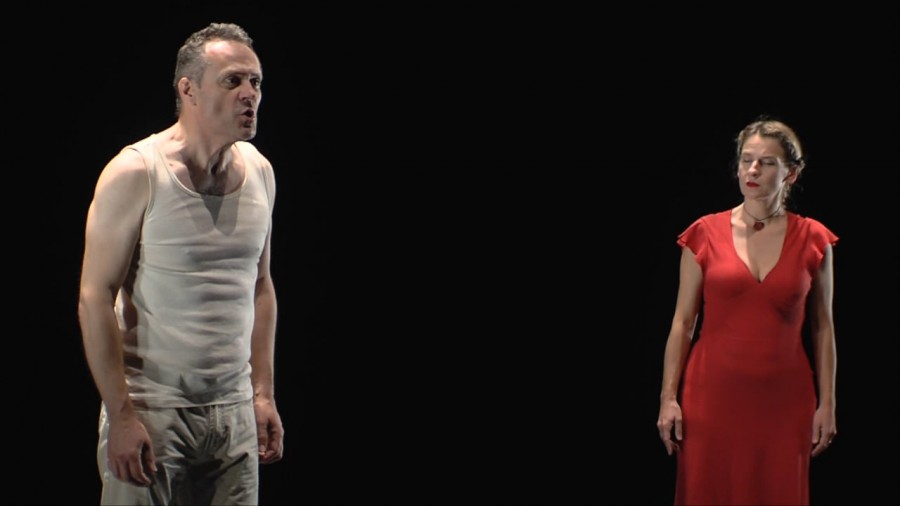
Karine Mazel-Noury : « Le Chant des coquelicots est un champ d’expérimentation pour le nouveau conte »
Rencontrée à l’occasion du 10e festival EPOS à Vendôme (Loir-et-Cher) en juillet 2015, la conteuse a exposé la genèse de sa nouvelle création avec Pierre Deschamps, autour du couple et de la guerre.
Comment est né votre spectacle « Le Chant des coquelicots » ?
Au départ, Pierre Deschamps, de la compagnie La Grande Ourse, est venu me trouver pour que l’on travaille en duo sur un thème précis, la relation de couple pendant un conflit, et plus précisément pendant la guerre 14-18. Nous n’avions jamais eu l’occasion de collaborer auparavant sur un projet commun, nous avions juste participé tous les deux à la fondation de l’Association professionnelle des artistes conteurs (APAC), donc dans un cadre plutôt logistique et idéologique qu’artistique. Jamais je n’aurais imaginé que l’on puisse travailler ensemble parce que nous évoluons dans des registres assez différents.
S’il a pensé à moi, c’est pour deux raisons : la première, c’est que j’ai déjà abordé la question du couple dans l’un de mes précédents spectacles, La Légende de Thi Thiet (2014), inspiré d’une épopée vietnamienne du XVe siècle ; la seconde, c’est que je travaille depuis plusieurs années sur le rapport entre la parole et le corps, le langage et le mouvement, le conte et la danse.
Comment avez-vous procédé pour concevoir ce spectacle ?
Nous avons tout d’abord commencé à travailler sur la guerre de 14-18 en particulier, puis nous avons rapidement élargi notre champ de recherche à la guerre en général. Au fil des mois, nous avons recueilli une matière énorme, notamment des lettres de soldats à leurs épouses, des sources historiques, des reportages et documentaires, des émissions de radio, des films comme La Vie et rien d’autre (1989), de Bertrand Tavernier avec Sabine Azéma, etc. Nous avons également fait appel à une historienne, Clémentine Vidal-Naquet, qui a fait sa thèse précisément sur la relation de couple pendant le conflit de 14-18. Il se trouve par ailleurs que, de par son histoire personnelle, Pierre était directement concerné par le sujet. Il est né dans une famille de militaires avec énormément de souvenirs liés à la guerre. C’est donc avec grand intérêt qu’il a mené de nombreux entretiens avec des descendants de soldats, il a ainsi rassemblé une masse de témoignages qui ont nourri le spectacle. Parallèlement à cette recherche de nature historique, nous avons aussi collecté, dans le répertoire des contes traditionnels, tous les récits de départ sur le front, de relations de couple pendant un conflit, et plus largement tout ce qui avait trait à la guerre en général. Par exemple, toutes les histoires du soldat La Ramée.
À l’issue de ce considérable travail de collecte, nous nous sommes rendus compte à quel point il existait des liens entre tous ces récits, qu’ils soient issus des contes traditionnels ou des témoignages sur la vie quotidienne en temps de guerre. Finalement, la plupart des contes sont inscrits dans le concret de situations vécues au jour le jour par des hommes et des femmes pendant des conflits. Par exemple, le personnage de Bartholomé puise ses modèles à la fois dans la réalité de la guerre à l’image de tous ces soldats mutilés revenus du front avec des crochets à la place des mains, des bras ou des jambes, mais aussi dans l’univers du conte avec la figure récurrente du « prince-monstre », du « prince-dragon », du prince transformé en bête. De même, le personnage de Maria, la vieille du village que tout le monde vient consulter pour guérir les petits et grands maux de l’existence, tient à la fois de la guérisseuse/rebouteuse, indissociable de la tradition paysanne française, mais aussi de la figure de la sorcière si présente dans les récits oraux.
Il existe également des échos permanents entre l’histoire d’amour de Jeanne et François, les deux personnages du spectacle, et des figures issues de la mythologie ou de la tradition orale populaire. En fonction des situations, Jeanne peut évoquer Antigone ou Pénélope et François, Ulysse ou d’autres héros. C’est aussi pour signifier cet ancrage dans la mythologie que nous avons choisi d’insérer des extraits de L’Iliade, d’Homère, et que nous avons délibérément gommé toutes les références historiques trop marquées à la guerre de 14-18, notamment des mots comme « tranchées », « munitionnette » (Jeanne travaille dans une usine d’armement), « Allemands », etc.
De quelle façon ce spectacle s’inscrit-il dans la réflexion sur le « nouveau conte » ?
Quand Pierre est venu me proposer son projet de création, je commençais justement à formuler cette réflexion autour du « nouveau conte » et du coup, Le Chant des coquelicots est devenu en quelque sorte un champ d’expérimentation grandeur nature pour cette analyse. Tout d’abord, la conception de ce spectacle m’a permis d’approfondir mes recherches sur la corporalité et sur la notion d’écriture. J’ai toujours envisagé l’art du conteur comme un art non seulement du langage mais aussi du corps. A savoir que la parole, c’est du langage incarné, inscrit dans le corps. D’où tout notre travail autour des moments chorégraphiés, des mouvements corporels et à leur façon de s’insérer dans le spectacle.
Le Chant des coquelicots a aussi contribué à nourrir mes réflexions sur l’art du conteur. Je me sens avant tout artiste de spectacle vivant, ma discipline principale, c’est l’art du conte, mais je suis gênée de devoir me limiter à m’asseoir sur une chaise et à dire, à raconter des histoires parce que cela correspond à l’image d’Epinal du conteur traditionnel… J’ai toujours été mal à l’aise avec le fait de cloisonner les arts du spectacle, de vouloir à tout prix les étiqueter. C’est vrai que je ne suis pas danseuse, que je ne suis pas non plus chanteuse, néanmoins, je peux danser et je peux chanter. Je peux avoir recours à d’autres disciplines que la mienne sans pour autant perdre mon identité de conteuse. Tout est une question de dosage en fin de compte.
Enfin, nous avons également pu nous confronter à un autre point que j’aborde dans mon article sur le nouveau conte, à savoir le cloisonnement des réseaux de diffusion, l’absence de circulation entre le réseau conte et le réseau théâtre. Nous avons ainsi envisagé de développer deux formes de notre création, une « forme légère », qui peut tourner facilement dans de petites structures, et une « forme plateau ». Je me souviens quand j’ai collaboré avec Bernard Colin sur l’un de mes spectacles, La Légende de Thi Thiet, il m’avait dit : « Le point de départ de ton travail, c’est que tu puisses raconter cette histoire dans une cabine téléphonique ». Et bien cette image, elle m’est toujours restée en tête. Partir du plus petit pour ensuite élargir, dilater vers quelque chose de plus conséquent. Avec Le Chant des coquelicots, c’est la même chose. Nous avons conçu plusieurs formes pour pouvoir nous adapter aux différents lieux de représentation.
Le Chant des coquelicots (création 2015), de et par Pierre Deschamps et Karine Mazel-Noury (compagnies La Grande Ourse et Les Mots Tissés). Jusqu’au 18 avril 2016. Tous les lundis à 19h30. Durée : 1h10. Théâtre Les Déchargeurs, 3 rue des Déchargeurs, Paris 1er. www.lesdechargeurs.fr (lien direct vers http://www.lesdechargeurs.fr/spectacle/le-chant-des-coquelicots).
Les sites des artistes : www.pierre-deschamps.fr et lesmotstisses.org
Rencontré à Paris en février, le conteur est revenu sur le processus de création de son nouveau spectacle, Loki, pour ne pas perdre le nord, conçu et interprété avec la percussionniste Linda Edsjö.
Comment est né votre spectacle Loki, pour ne pas perdre le nord ?
Ce spectacle est avant tout une histoire à deux, c’est le fruit d’une rencontre avec la percussionniste Linda Edsjö, qui est également ma compagne. Cela fait désormais une dizaine d’années que nous vivons et travaillons ensemble. Notre précédente création en duo, Pas de deux, conçu autour de ses instruments de musicienne et compositrice, marimbas, vibraphones, etc., nous a donné l’envie de continuer dans cette veine de spectacles liant musique et conte. De par notre histoire familiale [elle est suédoise, je suis d’origine norvégienne par ma mère], nous sommes attirés tous les deux par la mythologie nordique depuis des années. Et je rêve depuis longtemps de faire quelque chose autour du personnage de Loki, une personnalité complexe et ambigüe comme je les aime, un diable à la fois créateur et destructeur, un « trickster » comme on les appelle en Amérique du Nord. J’en ai parlé à Linda qui a été complètement séduite par ce projet et qui a commencé à se renseigner sur ce personnage, qu’elle ne connaissait pas très bien malgré ses origines.
Comment avez-vous procédé pour concevoir ce spectacle ?
Nous avons accompli un important travail de recherche sur les textes existant autour de Loki, qui a duré près de trois ans. La traduction en français faite par Régis Boyer des manuscrits de littérature scandinave datant du XIIe siècle a été d’une aide précieuse. Par ailleurs, Linda a aussi eu accès à la version en norvégien contemporain de ces textes rédigés à l’origine en vieux norrois (langue scandinave médiévale). Une grande partie de nos efforts a porté sur la manière de rendre compréhensible au plus large public possible un récit mythologique rédigé en partie en prose mais aussi en vers.
Parallèlement à cet énorme travail préparatoire sur les textes de la mythologie nordique, Linda et moi avons aussi entrepris des recherches au niveau musical pour trouver un instrument qui nous permette de créer tous les deux côte à côte pour accompagner notre récit sur le plan sonore. C’est au cours de ces recherches que nous avons découvert la table sonorisée (ou électroacoustique) grâce à Jean-Pierre Drouet, l’un des plus grands percussionnistes contemporains français. De fil en aiguille, nous avons rencontré Wilfried Wendling, de La Muse en circuit, qui a accepté de travailler avec nous sur cette idée d’une table sonorisée sur laquelle nous pourrions créer une partition musicale, Linda et moi. Là aussi, il nous a fallu du temps pour trouver la bonne qualité de bois pour concevoir cette table, pour définir le mode de captation des sons, les liens avec les ordinateurs, pour créer la dimension électroacoustique du spectacle. Et puis, il a fallu également réfléchir à la mise en scène du tableau final, le « Ragnarok », la fin du monde.
Comment définissez-vous ce spectacle ? Est-ce encore du conte ou autre chose ?
J’entends déjà certains dire : « Ça y est, tu as encore fait un OVNI, un spectacle atypique, que l’on ne va pas savoir où classer ». C’est typiquement français, cette manie de tout classer, de tout mettre en catégories, de tout ranger dans des cases. Et une fois que l’on a tout bien rangé, on n’a plus le droit de sortir de sa case, de mélanger les genres. Or le mélange est extrêmement bon pour la santé. C’est une bonne chose, me semble-t-il, que le public puisse mobiliser plusieurs de ses sens, et non pas un seul, quand il va voir un spectacle. La pluridisciplinarité pose souvent problème en France, ce qui n’est absolument pas le cas dans les pays anglo-saxons. Aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, les spectateurs sont habitués au pluridisciplinaire. Je trouve ça vraiment dommage de ne pas laisser leur chance aux arts de se mélanger, mais pour se mélanger, il faut bien se connaître les uns les autres. Et c’est peut-être cela qui manque parfois dans certains spectacles pluridisciplinaires, une bonne connaissance et une parfaite maîtrise des différentes disciplines artistiques utilisées. Et puis ce genre de spectacles nécessitent beaucoup de temps, à la fois dans leur conception, mais aussi dans leur acceptation par le public, or, on ne laisse pas toujours le temps aux artistes de s’installer dans la durée, de donner des représentations sur le long terme. En tout cas, pour en revenir à Loki, même si j’explore plein d’autres pistes, la musique, la gestuelle, le duo, le rapport avec l’espace et le mouvement, j’essaie de faire en sorte que ça reste quand même un spectacle de conteur fondé sur une histoire que je raconte au public, sur une relation avec les spectateurs.
Un autre reproche que j’entends souvent à propos de mes spectacles, c’est que, de par leur mise en scène assez conséquente, ils ne s’adaptent pas à tous les lieux de représentation, en particulier les petites salles, contrairement aux spectacles de conte traditionnels. Bien au contraire, c’est un défi constant à mes yeux d’être capable de s’adapter à n’importe quel lieu de représentation, de pouvoir continuer à jouer n’importe où… Avec Linda, nous avons tenté il y a quelque temps une expérience très intéressante avec Loki. Nous avons donné une représentation du spectacle à Paris dans une médiathèque du 18e arrondissement. Pour l’occasion, nous avons troqué notre grande table sonorisée habituelle contre une simple table de salle de réunion tout à fait classique et nous avons présenté à peu près 60 % du spectacle pour une durée de 45 minutes (contre 1h30 en temps normal). Le tout devant un public très mélangé au niveau des âges et des origines, d’un côté des petites Black de 7-8 ans, de l’autre, des mémés de médiathèque, avec au milieu deux ou trois Polonais venus apprendre le français. La preuve que même avec un spectacle comme Loki, on peut toujours jouer n’importe où devant n’importe quel public. Bien sûr, nous n’avons pas pu représenter la scène de la fin du monde avec tous les effets pyrotechniques comme dans une grande salle de spectacles, mais nous avons pu la raconter tout simplement et la petite table de la médiathèque a produit des sonorités tout à fait intéressantes. Avec Linda, nous étions vraiment ravis de cette expérience.
Par ailleurs, je suis très content de pouvoir donner plusieurs représentations de Loki dans la salle de L’Étoile du Nord à Paris à partir du 29 mars. D’une part, c’est une salle avec une bonne configuration, pas trop grande ni trop petite, environ 120 places et avec une scène en gradin qui permettra au public d’avoir une bonne vision de la table sonorisée. D’autre part, il s’agit d’une salle de théâtre classique qui n’est pas uniquement réservée à un public d’habitués du conte et c’est important à mes yeux d’aller à la rencontre de publics différents.
Loki, pour ne pas perdre le nord (création 2015), un conte électroacoustique de et par Abbi Patrix et Linda Edsjö (compagnie du Cercle). Du 29 mars au 16 avril 2016. Mardi, mercredi et vendredi à 20h30, jeudi à 19h30, samedi à 17 heures. Durée : 1h30. L’Étoile du Nord, 16 rue Georgette Agutte, Paris 18e. ÉTOILE DU NORD (lien direct vers Loki).
Les sites des artistes : www.compagnieducercle.fr/fr/abbi-patrix et lindaedsjo.com
Propos recueillis par Cristina Marino
Les critiques de ces deux spectacles sont à découvrir sur le blog L’Arbre aux contes (L’ARBRE AUX CONTES).
__________________________________________________________________________________

J’ai déjà eu l’occasion à plusieurs reprises sur ce blog de dire à quel point je trouvais intéressant le travail mené depuis des années par Bruno de La Salle, fondateur du CLiO (Conservatoire contemporain de littérature orale), autour des épopées et des grands récits mythiques, notamment L’Odyssée. Et à quel point aussi la voix de sa fille, Aimée de La Salle, « chanteuse d’histoires », me fascinait, entre autres lors de mes reportages à Vendôme (Loir-et-Cher) pour le festival EPOS en juillet. Autant dire que je n’ai pas été déçue par leur présence à cette conférence autour des Mille et Une Nuits. Leur interprétation en duo de trois extraits de L’Amour interdit, une création conçue à partir de ce récit fondateur de la littérature orale, a véritablement enchanté le public venu nombreux assister à ce débat. Ils y ont mêlé avec talent la parole, le chant et la musique, avec, pour Bruno de La Salle, son impressionnant Cristal Baschet et, pour Aimée, une tampura (ou tempura, instrument à cordes indien). L’occasion de rendre hommage au grand talent du compositeur Jean-Paul Auboux, disparu en juillet 2006, qui a composé pour le spectacle d’Aimée et Bruno de La Salle une partition remarquable inspirée de la musique indienne.
Ils reprennent l’un des plus magnifiques, mais rarement cités, contes qui constituent le recueil des Mille et Une Nuits, L’Amour interdit marque l’aboutissement de la plaidoirie de Shéhérazade en faveur de l’amour, c’est le dernier récit qu’elle raconte au roi Shahryar pour avoir la vie sauve. Il s’agit d’une histoire intemporelle, au même titre que Roméo et Juliette ou Tristan et Iseult : lors d’une rencontre fortuite dans une boutique du bazar de Bagdad, le prince persan Ali Ben Bekar et la princesse Shams al Naar (« Soleil du jour »), favorite du calife Haroun al Rachid, s’éprennent l’un de l’autre. Un amour impossible et presque vertueux, la description de trois rencontres à chaque fois brisées qui conduisent inéluctablement les protagonistes vers leur destin tragique, la mort.
En plus de ces intermèdes contés et chantés de grande qualité, cette conférence a bénéficié des interventions très bien documentées et pertinentes d’Aboubakr Chraïbi, professeur à l’Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales) et spécialiste reconnu des Mille et Une Nuits. Le tout orchestré de main de maître par Bernadette Bricout, professeure émérite de littérature orale à l’université Paris Diderot, chargée de mission « Cultures du monde » auprès du vice-président de Paris 7 à la vie culturelle et à l’université dans la ville, Pascal Dibie, par ailleurs conceptrice et animatrice des « Amphis 21 » à Sciences Po, des cycles de conférences sur les grandes questions du XXIe siècle.
Il est particulièrement difficile de résumer en quelques lignes sur ce blog l’extrême richesse de toutes les interventions qui ont eu lieu au cours de la soirée. Mais dans les grandes lignes, l’accent a porté sur l’importance dans la tradition orale de ce vaste récit, multiforme et inclassable, que sont Les Mille et Une Nuits, qui relèvent du patrimoine immatériel de l’humanité. A été souligné également le fait que le récit de Shéhérazade, qui est au cœur de cette épopée mythique, repose sur une parole nocturne, interrompue systématiquement par le retour de l’aube. Cette parole de nuit emblématique du conte est aussi une parole salvatrice dont dépend la survie même de l’héroïne. En effet, si Shéhérazade ne parvient pas à éveiller nuit après nuit la curiosité du roi Shahryar, elle subira le même sort que toutes les autres femmes du royaume : décapitée au petit matin.
Parmi les autres points abordés au cours de la conférence, notons aussi le nombre impressionnant de récits enchâssés comme des poupées russes dans le récit-cadre, élément central, des Mille et Une Nuits, ainsi que la multiplicité et la diversité des traductions qui existent à travers le monde à partir des manuscrits originels. Pour sa part, Bruno de La Salle a travaillé pour créer son spectacle sur la traduction d’Antoine Galland, la première en français, réalisée entre 1704 et 1717. Les innombrables adaptations cinématographiques de ce chef-d’œuvre de la littérature mondiale ont été aussi rapidement évoquées, de Pier Paolo Pasolini à Walt Disney, en passant par Claude Zidi et Bollywood. Les écrivains à se réclamer de l’héritage de Shérérazade ont également été légion, à l’image de Balzac qui voyait La Comédie humaine comme le Mille et Une Nuits de l’Occident, ou de Marcel Proust qui place sa Recherche du temps perdu sous le signe de la nuit de ce récit millénaire.
On pourrait étendre sans fin ce compte-rendu détaillé de tous les angles évoqués pendant le débat à Paris Diderot mais à l’image de Shéhérazade, qui interrompt son récit tous les matins dès l’aube venue, je vais m’arrêter là dans cette énumération. Juste préciser que les deux heures de cette conférence ont filé à vitesse grand V et qu’en fin de conte, le public s’est retrouvé dans la nuit parisienne avec, dans la tête, la mélodieuse voix d’Aimée-Shéhérazade lui susurrant à l’oreille, comme à sa sœur cadette Dinarzade : « Ferme les yeux, petite sœur/Laisse s’approcher le sommeil/Il t’apporte son lait de miel/Il te baignera de merveilles/Laisse tes yeux se fermer/Le jour va se lever/Il chassera l’obscurité/Il emportera le danger/Laisse ta frayeur s’échapper/Ta fatigue se réparer. »
__________________________________________________________________________________

Ces scènes professionnelles permettent aux artistes de vendre leurs spectacles, c’est à dire de leur donner un chance d’être partagés avec un public — ce qui est une nécessité à la fois économique et personnelle — et aux responsables culturels de faire leur programmation en limitant le temps et l’argent investi. Je vous propose donc une réflexion sur ce moyen de «gagner du temps et de l’argent» déjà utilisé par les autres arts du spectacle depuis longtemps.
Les limites de la scène pro
Dans le milieu du conte, pour un nombre important de responsables, la programmation représente une mission parmi d’autres, voire une activité bénévole. C’est le cas par exemple des bibliothèques, et associations. Pour ces personnes se déplacer pour assister à des représentations tout au long de l’année est souvent une réelle difficulté car le temps et les moyens ne sont pas toujours disponibles.
Du côté des directeurs artistiques dont c’est le cœur de métier et qui ont reçu une formation spécifique (direction de salles de spectacles, attachés culturel, etc), ils sont sollicités de manière tellement exponentielle qu’ils en viennent à ne plus savoir où donner de l’œil et de l’oreille.
C’est sans doute ce constat d’un manque de temps et de moyens, qui pousse nombres d’entre eux à participer, voire à organiser des journées professionnelles. Quant aux artistes qui y participent, on comprend aisément que ce qui les motive est la perspective de vendre un maximum de représentations en un minimum de temps. La plupart d’entre eux n’ont en effet ni agent, ni chargé de diffusion et cet aspect du travail représente une réelle difficulté, voire un handicap.
Mais le moyen utilisé pour répondre à ces différents besoins ne risque t-il pas, à terme, de réduire la diversité et le nombre de spectacles proposés au public ? Ne risque t-on pas de se retrouver avec des programmations à l’identique avec les quelques spectacles sélectionnés ?
Combien d’œuvres singulières et de qualité sont écartées par les comités de sélection des scènes pros, car elle ne rentrent pas dans un cahier des charges qui tente de satisfaire un plus grand nombre ? Certains programmateurs ne vont-ils pas, compte-tenu des difficultés décrites plus haut, s’affranchir d’assister régulièrement à des représentations ?
Si l’on n’y prend pas garde, les scènes professionnelles peuvent devenir, une sorte de Meetic de la relation programmateur-artistes. Et s’il est vrai que bien des relations amoureuse sont nées grâce à ce logiciel Meetic, combien aussi n’ont pas eu lieu, simplement parce que l’ordinateur n’as pas estimé, selon ses critères, que ces deux personnes étaient compatibles ? Combien de relations improbables et passionnantes avons-nous vécues avec des personnes que jamais aucun logiciel ne nous aurait proposées? Combien de spectacles et d’artistes avons-nous découvert qu’aucune scène professionnelle n’aurait jamais invités ? À force de vouloir rentabiliser, et rationaliser pour gagner en efficacité, ne sommes-nous pas en train de réduire le champ des possibles, du singulier, et d’uniformiser ? Que devient la vision d’une direction artistique, quand une pré-sélection réduit d’emblée la possibilités d’exercer sa subjectivité et sa sensibilité ?
En outre, certaines journées professionnelles ont parfois des airs de Star Académie, ou de jeux du cirque modernes. Ceux et celles qui y participent sont assassinés ou encensés en quelques minutes. On se penche vers son voisin et on dit «t’as vu untel, c’était génial !» ou bien « t’as entendu machin, on a rien compris, c’était chiant à mourir ». Ou bien on griffonne quelques mots dans la « case prévue à cet effet » pour pouvoir se souvenir.
Certains conteurs déploient des stratégies de communication incroyables pour marquer les esprits – et on peut les comprendre, mais c’est rarement au bénéfice de la qualité de leur propos. J’ai vu un conteur « se transformer en légume » pour être certain d’être dans le « panier du marché de ces dames », et répéter trois fois son nom pour être sûr de ne pas être oublié. L’ambiance se fait lourde. Pourtant le conteur n’a fait que pousser au bout et rendre visible la logique marchande qui sous-tend la journée.
Du côté des programmateurs
Assister à neuf extraits de spectacles de vingt-cinq minutes dans une journée puis aller écouter un spectacle entier le soir, relève de l’exploit. On finit par se sentir un peu écœuré, tout se mélange, un peu comme quand on sort d’une parfumerie après avoir senti trop de parfums. Pourtant on le sait : après trois senteurs le nez et saturé. De même, après trois conteurs, les oreilles sont pleines.
Par ailleurs, les réunions de programmateurs et les scènes professionnelles posent des questions de pouvoir et d’ascendant dans lesquelles les relations interpersonnelles entre collègues sont déterminantes. Au cours d’une représentation nos impressions sont diverses et nuancées, ou au contraire très tranchées. On quitte parfois la salle un peu confus, plein de doutes et d’émotions. Mais dès qu’on se met à discuter avec nos amis ou collègues, un avis général se forme. La fatigue, la peur du conflit, les enjeux de pouvoir, les tempéraments, nous conduisent parfois à nous ranger derrière l’avis général. J’ai souvent constaté que le récit collectif qui s’élabore au cours des échanges après une représentation, finit par remplacer la singularité et la complexité de perception de chacun.
Quand on assiste à une scène professionnelle on a déjà partiellement délégué notre responsabilité de décision à un comité de sélection et il arrive qu’on la délègue une seconde fois en se rangeant derrière le fameux « avis général ». D’autres fois, heureusement, les discussions enrichissent notre vision sans influencer notre décision mais plus le temps est compté moins on a le temps d’échanger de manière constructive et ouverte.
J’ai personnellement pu éprouver, au cours de mon travail de direction artistique à Plaine Commune, combien il est différent d’écouter des extraits de contes au cours de scènes professionnelles et d’aller assister à une représentation complète.
Dans le premier cas, j’ai ressenti un appétit et un enthousiasme de découvrir tant de paroles. Mais au fil du temps j’ai également perçu les limites d’un système qui, quelle que soit la qualité des artistes présents, va désavantager les uns et avantager les autres. Dans ce contexte en effet, certaines paroles deviennent rivales plutôt que complémentaires ; à côté de propositions drôles, musicales et dynamiques, la douceur, la lenteur et le silence peuvent se confondre avec la mollesse. D’ailleurs les conteurs ne s’y trompent pas et viennent avec des propositions assez conventionnelles et légères. Pour plaire au plus grand nombre, on a tendance à lisser nos propositions. La question d’une certaine uniformisation se pose donc.
Dans l’autre cas, j’ai pris le temps d’aller voir un spectacle en entier. Je me suis installée et j’ai écouté, regardé, un ou plusieurs artistes, une histoire, pendant une heure. J’ai écouté la salle aussi. Car si un spectacle ne me plait pas mais qu’il est de qualité, que le public réagit positivement et qu’il rentre dans mon « cahier des charges », je peux décider de l’inviter. À la sortie, j’ai écouté les discussions, parfois échangé quelques mots. J’ai ensuite médité sur mes impressions. Je me suis questionnée sur mes réactions personnelles, sur l’œuvre, ses enjeux, sa pertinence dans le contexte de ma programmation, sans que personne n’intervienne dans cette élaboration intérieure. J’avais passé une heure en compagnie d’un artiste et de son œuvre, j’avais donc matière à réflexion. J’ai bien sûr aussi fait cette analyse après la scène professionnelle, mais avec un sentiment d’incertitude dans la mesure où je n’avais vu qu’un extrait de spectacle et où mes souvenirs se mélangeaient.
… et des artistes
J’aimerais à présent me placer du point de vue des artistes. Une grande majorité d’entre eux affirme qu’une scène professionnelle est une épreuve mais aussi une nécessité « parce qu’il y a de moins en moins de boulot ». Mais quelle est la nature de cette épreuve à laquelle on se soumet pour survivre ? Qu’est-ce qui nous fait tant souffrir ? Pourquoi ne pas simplement se réjouir de l’opportunité qui nous est offerte de montrer notre travail à tant d’acheteurs potentiels en même temps ?
Si l’on s’accorde sur le fait que ces scènes professionnelles répondent à un besoin, pour les uns d’acheter, et pour les autres de vendre, on comprend que cela puisse poser question aux artistes. Cette situation le transforme insidieusement en commercial de lui-même. Parce qu’il n’y a pas d’autre objet que soi à exposer aux regards, on se sent réifié, réduit à la dimension d’un produit à vendre. Ce sentiment est renforcé quand, avec toutes les bonnes intentions du monde, les organisateurs installent des tables avec les noms des conteurs qui attendent les programmateurs à la sortie. On voit alors des bousculades autour de certaines tables alors que d’autres restent désertes. Comment ne pas se sentir diminué, dévalorisé dans ce genre de situations ?
C’est la loi du marché, ce jour-là on n’a pas emporté le morceau et ça se voit, c’est la règle du jeu à accepter ! On a passé des centaines d’heures à imaginer, créer, puis affiner, enrichir, approfondir, élaguer, peaufiner une œuvre qu’il a fallu couper, arranger et présenter en quelques minutes. Comment convaincre, alors que nous doutons nous-même ? Et convaincre de quoi, que notre spectacle est bon et qu’il vaut mieux que celui de notre collègue dont nous estimons pourtant le travail ? Parce que la réalité sous-jacente à ces situations est que nous sommes mis malgré nous en concurrence. Certain gèrent cette situation, d’autres moins, il faut reconnaître que nous ne sommes pas égaux en la matière.
Il y a par ailleurs une pratique des « scènes ouvertes » ou « programmations off » au sein de quelques festivals qui me semble tout à fait discutable. Je rapporte ici à titre d’exemple, une discussion que j’ai eue avec des artistes à l’issue d’une représentation à laquelle je venais d’assister :
« Quoi, comment, pourquoi n’êtes-vous ni payés, ni défrayés pour cette représentation, vous êtes pourtant dans le programme !?
Ah bon ! On n’est pas payé quand on est dans le off ?
Mais qui est à l’initiative de ce off ?
— L’équipe du festival !
— Ça veut dire qu’ils font deux programmations, l’une payée et payante, et l’autre bénévole et gratuite ?! Mais enfin, ça n’a rien à voir avec le principe d’Avignon, le In et le Off sont complètement distincts en terme d’organisation ! »
Ils m’ont répondu un peu gênés :
« Ici, c’est comme ça, et puis les temps sont durs et c’est une chance d’être là et de pouvoir montrer son travail. »
Cet argument est tout à fait légitime de la part d’un conteur professionnel. Pourtant ces artistes n’étaient pas des débutants ou des artistes en voie de professionnalisation, mais au contraire des conteurs aguerris.
Je me suis insurgée : « Si je comprends bien, le festival se paye une programmation à moitié prix, avec des artistes de qualité et reconnus, avec comme bonne intention affichée de les aider à tourner ? » En parlant avec d’autres collègues j’ai découvert que beaucoup dénonçaient ces pratiques mais continuaient pourtant à postuler : « Y’ à du monde, y’a des pros, alors on y va, y’a pas le choix si on veut bosser. » Cette réflexion se comprend, ô combien, tant la réduction des budgets et l’augmentation du nombre de conteurs a rendu difficile le fait de gagner sa vie en racontant des histoires.
Il paraît que certains tirent leur épingle du jeu et repartent avec des agendas bien remplis et c’est tant mieux. Mais on peut se demander s’il est réellement satisfaisant d’obtenir des engagements dans ces conditions. Combien repartent par ailleurs les mains vides avec le sentiment de ne pas avoir été respectés, considérés, ni même remerciés pour leur contribution. Parce qu’ils contribuent au succès de ces festivals qui, sans «la servitude volontaire» de nombreux artistes, ne seraient pas ce qu’il sont. Des artistes confirmés jouent gratuitement et doivent en plus payer leurs trajets, leurs repas, leur hébergement, ainsi que les représentations payantes des collègues auxquelles ils assistent. C’est peut-être une chance d’y participer mais cela coûte cher, à tout les sens du terme.
Hors des sentiers battus
Alors certains conteurs inventent leurs scènes professionnelles et certaines de ces tentatives montrent qu’il est possible d’éviter ces situations pénibles. Ils limitent le nombre de conteurs et mettent au centre l’échange et le partage entre artistes et avec les programmateurs. Certains artistes ont envie de savoir à quel type de projet ils participent, et pas seulement de savoir s’ils sont « pris ou pas ». Ils ont envie d’exposer leur démarche, d’entendre celle de leurs collègues et aussi celle des directeurs artistiques. Si ces journées sont placées sous le signe de la rencontre, de la réflexion et du travail en commun, alors la question marchande passe au second plan. Sans disparaître, elle devient une conséquence et non pas un but. La pression descend des deux côtés, parce qu’on n’est plus dans une relation de pouvoir dans laquelle on gagne ou on perd. Certains conteurs réalisent également ensemble un spectacle collectif dans lequel les paroles de chacun se répondent et se complètent sans jamais entrer en concurrence. D’autres encore font le choix de présenter seulement 4 spectacles mais en entier. Je me réjouis que ce genre d’initiatives solidaires se multiplie car elles sont une réponse positive et innovante à certaines pratiques discutables qui tendent à se généraliser.
La question de la diffusion est à la fois cruciale et délaissée par les artistes qui se sentent souvent démunis, et beaucoup d’entre nous créons sans partenariats ni stratégies. Rares sont ceux qui sont accompagnés par un agent et/ou une équipe administrative garant de la vie de nos créations. Il y a un manque important de structuration et de moyens dans notre milieu. Certains réfléchissent au moyen de contourner le réseau de diffusion classique et de créer leurs propres outils de diffusion. Ce sera peut-être une solution, peut-être pas. Cela pourrait renforcer une sorte de « culture à deux vitesse » et précariser d’avantage certains d’entre nous. Du côté des directeurs artistiques le cahier des charges imposé par le politique est parfois intenable, les coupes budgétaires se multiplient et garder le cap s’avère difficile dans ce contexte.
Je crois que c’est toute la relation entre artistes et directeurs artistiques qui est à repenser. C’est un vœu pieux, une utopie diront certains. Raison de plus. Nous avons à nous reconsidérer les uns les autres et à nous souvenir que nous sommes des partenaires engagés sur le même bateau dans une interdépendance. Nous aurions tout à gagner à créer des espaces de collaboration et de dialogue solidaires entre artistes et programmateurs, à l’abri de toute intention marchande, pour mieux nous connaître et nous comprendre. L’Association Professionnelle des Artistes Conteurs à un projet qui va dans ce sens. Je lui souhaite d’être entendue et suivie dans sa démarche. Elle vous donne rendez-vous les 15 février, 21 mars et 11 avril, à l’Espace Jemmapes à Paris pour engager le dialogue autour de ces questions.
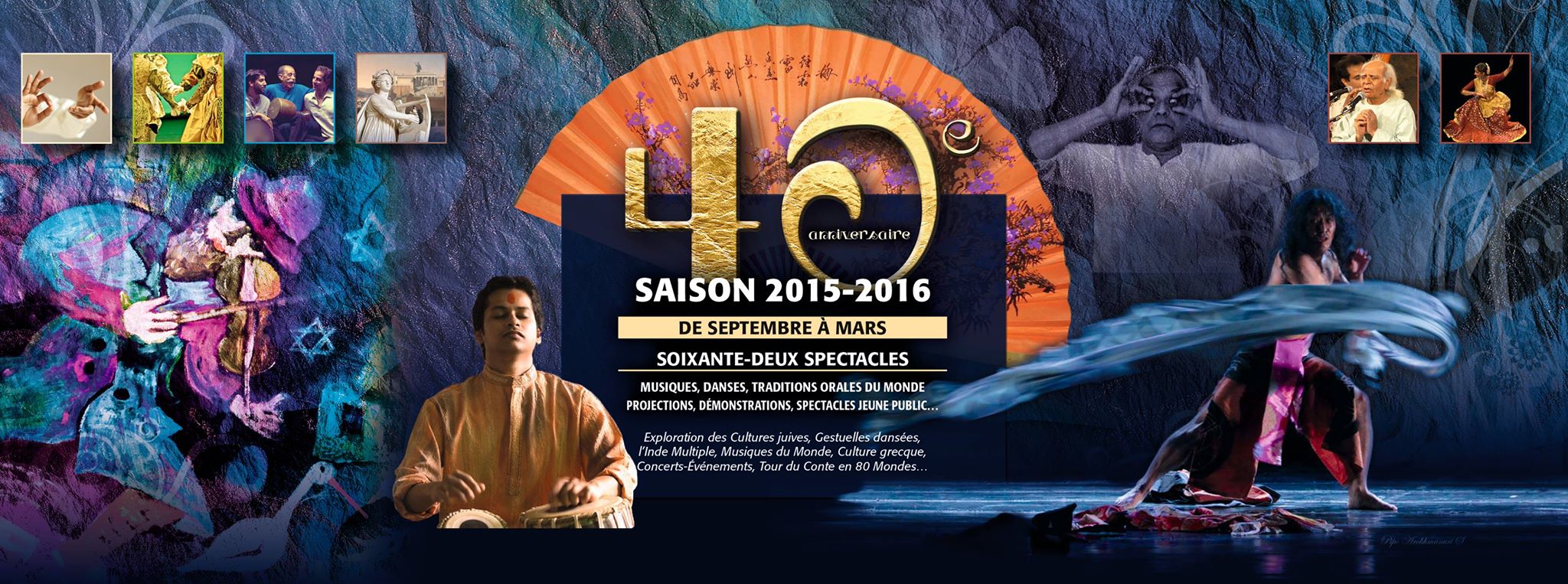
« Il était une fois » dans le 18e montmartrois… où les protagonistes de cette histoire ont passé leur enfance à quelques mètres l’un de l’autre, sans le savoir : un bâtisseur né, appelons-le ainsi, et une danseuse à l’affût de découvertes, tous deux amoureux de l’Inde. Car c’est l’Inde qui les fit se rencontrer quelque 30 ans plus tard, réunissant dans un même enthousiasme leurs intérêts profonds dans la vie et dans l’art. C’est ainsi qu’à l’automne 1975 naquit le Mandapa de la pioche du bâtisseur. Encore insolite pour beaucoup, ce lieu devint rapidement le rendez-vous d’à peu près toutes les cultures de la mappemonde, peu s’en faut… sans oublier l’Inde et ses infinies richesses : musicales, chorégraphiques, et mythologiques, bien évidemment ! Mais le destin (encore lui…) voulut que vers la même période le renouveau de l’Art du Conte soit dans l’air du temps et s’insinue dans les circuits professionnels. De là à s’intégrer au programme du Mandapa, il n’y avait qu’un pas vite franchi. Une bibliothécaire du quartier eut la bonne initiative de nous vanter les talents de Catherine Zarcate, quelle découverte ! Elle fut notre première conteuse, mais son entrée au Mandapa fut précédée de questions qui en disaient long sur le chemin encore à parcourir pour la reconnaissance du métier de conteur… : « Que va-t-elle faire ? Nous lire une histoire ? ». Sa première soirée au Mandapa fut plutôt intime… mais pas pour longtemps ! Peu après, Catherine et ses inoubliables « Contes du Vampire » ont fait salle comble et retenu une nuit entière un public avide d’écoute, insatiable. Le Mandapa, intime et convivial, s’avérait être un lieu propice à l’art de la parole. Notre festival annuel « Contes d’Hiver, contes divers… » prit son essor au début des années 80. Depuis, il accueille chaque année, au cœur même de l’hiver, des conteurs de toute origine, porteurs et « passeurs » de cultures issues de tous les horizons, dont les maestros bien connus. Parmi ceux-ci, Bruno de La Salle et le CLiO, pionniers dans ce domaine, nous ont fidèlement accompagnés et soutenus dès le début de cette passionnante aventure. Énumérer les artistes-conteurs, conteurs-musiciens, conteurs-danseurs, comédiens-conteurs et autres spécificités, qui se sont inscrits dans nos programmations serait une entreprise quasi galaxique ! Et tout au long de ces années, nos Contes d’Hiver n’ont pas failli, offrant les thèmes les plus divers : « Contes dits, joués, dansés », « Narrations en Musique », et depuis peu, un « Tour du Conte en 80 mondes ! », pour mieux vous convier à ne pas manquer cette croisière au très long cours…
Mais ne dit-on pas que même les plus beaux contes ont une fin ?… qui heureusement n’en est pas une… « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de conteurs ! »
